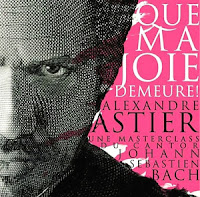Les fines gâchettes ont du mal à rater la cible & les trop tendres s'acoquinent avec des princesses...
Il y en a des piles
éparpillées dans toute la baraque, assez pour constituer un
chapelet en kevlar de motifs de divorce. Et me prier de faire un
peu de rangement reviendrait à demander à Jérémy Toulalan de
gagner le Ballon d'Or, je voudrais bien mais mon gène du ménage
flirte avec la zone de relégation en CFA2... Y en a partout, des
années de presse musicale entassées comme on peut dans les recoins
ou planquées sous les tapis. De Rolling Stone aux Inrocks
en passant par Rock and Folk, des magazines froissés, cornés,
lus et relus jusqu'à la dernière critique de vieux vinyle réédité,
un bain bouillant d'électricité plein de tout ce qui a pu se tramer
dans tous les studios de la planète.
Parmi ces pages,
régulièrement, des interviews de grands noms de la gamme ou
d'obscurs nouveau-nés abandonnés encore gluants sur le bord
de la route pop-rock. Un panier grouillant de héros du décibel
élargi à la gonflette, de songwriters avec une anecdote à raconter
sur chaque jour de leur existence, de vieux chanteurs de groupes mythiques
qui déblatèrent ivres morts sur des conneries en les faisant sonner
comme si c'était des extraits de la Bible, et j'en passe. Et quelque
part dans la discussion, chacun a droit à la question « quel
est le premier disque que vous avez acheté ? » et c'est
toujours extrêmement intéressant de voir à quel point les génies
ont du génie très précoce. Ils ont tous eu la présence d'esprit
d'acheter un truc qui la pète avant même de savoir marcher bien
droit. Pour un peu ça donnerait l'impression que tu ne peux pas
vendre le moindre CD si tu t'es rendu coupable d'un achat honteux
dans ta jeunesse.
Sauf que ça titille ce
qu'il me reste d'esprit critique et de tu vas pas me la faire à
moi. Parce que si je veux bien admettre qu'on tape dans le mille
une fois de temps en temps, j'ai du mal à croire qu'il suffit d'être
célèbre et d'avoir une carrière pour avoir déniché pile ce qu'il
fallait comme premier disque. L'histoire du guitar-hero du Havre qui
à l'âge de six ans, ses premières thunes en poche, est allé
acheter le 33 tours d'un bluesman enregistré live en septembre 1957
dans une boîte du south side de Chicago, je veux bien mais ça sent
l'œuvre de fiction de A à Z qui déborde même un peu sur
l'alphabet grec. Et vous pourrez éplucher toute la presse rock sur
les trente dernières années, vous ne trouverez aucun artiste
s'étant rendu coupable de faute de goût au moment de choisir son
premier disque. Et encore une fois, je veux bien, mais c'est
mathématiquement pas possible. Il y a forcément une exception qui
traîne quelque part. Ou alors c'est une opération marketing
contractuelle comme il est de rigueur par les temps foireux qui
courent, les musiciens sont-ils devenus de foutus commerciaux qui se
servent de références un peu classes voire inventées de toutes
pièces pour en mettre un bon coup aux ventes ?
Et soudainement je
regrette de n'être jamais interviewé par ces magazines, parce que
si ça m'arrivait, au moment de la fameuse question, je prendrais cet
air qu'ils prennent tous, cet air de vieil oiseau qui a bien baroudé
la clope et le whisky, et je répondrais la vérité crue,
inconfortable, sans additifs ni édulcorants. Ma maison de disques
m'enverrait certainement pourrir à Guantanamo après ça, non sans
m'avoir tranché la langue au coupe-ongles au préalable...
– Thierry Alves [bon
déjà ça fait pas nom de groupe à succès ni de chanteur de charme
(à moins qu'il s'agisse de charmer des touffes de poils) mais
faites semblant de rien, NDLR], vous souvenez-vous du
premier disque que vous avez acheté ?
– Ouais... Très bien... C'était en 1986, plutôt vers le
printemps, j'avais donc dix ans et des poussières. Je vivais dans un
petit village perdu du sud de la France, Saturargues ça s'appelait,
dans l'Hérault de l'Est. J'étais du genre premier de la classe
taciturne, voyez. Je passais le plus clair de mon temps libre à
m'évader en écoutant les disques à la demande sur Radio Vidourle,
une radio associative du coin qui grésillait pas mal sur la chaîne
hifi Akaï que mes parents s'étaient offerte récemment. Je rêvais même
d'être animateur radio une fois plus grand, si ça devait par
malheur arriver. J'écoutais beaucoup Philippe Cataldo, Gold ou
Samantha Fox, mes premières influences artistiques... J'avais
d'ailleurs très vite abandonné mes ambitions d'animateur radio au
profit d'une carrière de joueur de synthé avec coupe en brosse
platine. Suite logique, un jour, j'ai décidé que pour une fois je
n'achèterais pas un paquet de bonbons Krema Regal'ad à l'épicerie
du village, ouverte de 16 à 18 heures, avec mon argent de poche du
mois, mais un disque. Un disque à moi... Le samedi suivant, me voici
sur la Nationale 113, assis à l'arrière de la Renault 18
bordeaux de mon père pour les traditionnelles emplettes hebdomadaires au Leclerc de
Lunel, une ville située à cinq kilomètres de la maison. Sur la
liste des courses il y avait des pâtes et de la purée Vico si je me souviens bien. Nous
étions une famille très modeste, ma mère écrivait sa liste au dos
du ticket de caisse de la semaine précédente... Arrivé dans le
magasin, je me suis immédiatement dirigé vers le rayon musique,
impatient d'en extraire moi-même un disque qui m'appartiendrait. C'était un moment
magique comme nous les réserve la vie parfois, si on sait s'y
prendre correctement. C'était comme pénétrer la caverne d'Ali
Baba, il y avait l'embarras de cinq choix, et là-dedans une pochette qui représentait un genre de travelo toulonnais en débardeur, j'ai tout de suite su que j'avais trouvé mon disque. Ce disque, c'était le 45 tours Ouragan de Stéphanie de
Monaco, qui devait figurer à la première place du Top 50 à ce
moment-là, autant dire une sacrée pointure. Mes premiers pas de
tout jeune mélomane, je vous raconte pas la fierté de passer en
caisse avec mon billet de vingt francs. J'avais gagné mes galons de
p'tit clou comme on le disait en ce temps-là... Ouais...
Belle époque... Le disque doit aujourd'hui encore traîner quelque
part chez ma mère, à deux pas du fameux Leclerc...
En 1986, sans le savoir,
j'ai donc cramé tout espoir de carrière musicale. Mais la purée
était délicieuse.
That's all fucking folks...